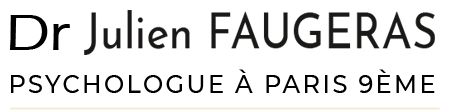Quelques incidences psychiques, épistémiques et sociales du fantasme de castration
Julien Faugeras
À Paris, le 12 décembre 2024
En découvrant le rôle fondamental des fantasmes inconscients dans les expressions symptomatiques des êtres humains, Sigmund Freud a ouvert une nouvelle perspective quant à la lecture des symptômes et surtout, quant à leur résolution.
Mais au-delà des incidences thérapeutiques de cette découverte, il est possible de remarquer ses conséquences politiques, et ce d’autant plus que Freud souligne la dimension universelle de certains fantasmes infantiles.
"L’hypothèse du même organe génital (masculin) chez tous les êtres humains est la première des théories sexuelles infantiles dignes d’être notées et lourdes de conséquences. Il est de peu de profit pour l’enfant que la science biologique doive donner raison à son préjugé et reconnaître le clitoris féminin comme un véritable substitut du pénis. La petite fille n’en vient pas à ce genre de mise à l’écart quand elle aperçoit l’organe génital du garçon qui est autrement conformé. Elle est aussitôt disposée à reconnaître cela et elle succombe à l’envie de pénis qui atteint son point culminant dans le souhait, important pour la suite, d’être elle aussi un garçon."[1]
Les répercussions de cette théorie sexuelle infantile sont effectivement lourdes de conséquences, tant pour l’être de sexe masculin que pour l’être de sexe féminin. Dans cette logique fantasmatique qui part du postulat qu’il n’y a qu’un seul sexe, le Moi infantile peut appréhender la différence des sexes de manière binaire, erronée et interpréter ainsi qu’il y a ceux qui sont pourvus et ceux qui sont châtrés, ceux qui en ont un grand et ceux qui en ont un petit, ceux qui sont privilégiés et ceux qui sont défavorisés ou encore ceux qui sont bénis et ceux qui sont punis.
Si ces lectures fantasmatiques de la différence des sexes sont manifestes dans le discours des enfants, la psychanalyse met en lumière que ces préjugés sont amenés à être refoulés et ainsi, à perdurer de manière voilée tout au long de la vie. Autrement dit, quand le fantasme originaire[2] devient inconscient, il n’apparait plus distinctement mais se repère à travers ses innombrables déplacements.
De la tendance du Moi à s’illusionner sur sa supériorité, à la peur obsédante de perdre ce qu’il pense posséder, de la quête insatiable de gagner, d’avoir toujours plus, à la soif inextinguible de faire reconnaitre ses qualités, ou encore, de la peur du sexe féminin à la tendance à le dénigrer, les manifestations symptomatiques du fantasme inconscient sont nombreuses. De même, elles peuvent se traduire par une tendance du Moi à se rabaisser, à se juger inférieur ou encore à se sentir lésé : sentiment déplacé d’injustice, de jalousie, de rivalité, sentiment de haine à l’égard du privilégié, revendication tyrannique d’égalité ou encore volonté tenace de se venger, d’obtenir compensation ou réparation.
Alors, si les psychanalystes peuvent remarquer les répercussions psychiques de ces théories infantiles refoulés, ils peuvent tout aussi bien relever leurs conséquences sociales.
De retour de l’école, une fille rapporte à sa mère que son ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) lui a dit que « les filles ont un petit kiki ». La mère étant psychanalyste, sensible à la signification phallique du terme kiki, elle rectifie tout de suite auprès de sa fille pour que cette dernière ne nourrisse pas une telle lecture dépréciative de son sexe.
Cette anecdote met en lumière comment le fantasme inconscient peut se diffuser insidieusement, ici dans le champ de l’Éducation nationale. Plus largement, cette théorie sexuelle infantile se représente depuis l’Antiquité en se confondant dans les systèmes éducatifs, familiaux, religieux, philosophiques et culturels.
À cet égard, s’il est plus facile aujourd’hui de repérer comment le fantasme de castration se représente au sein de systèmes où les femmes sont considérées et traitées comme des êtres inférieurs ou impurs, la théorie sexuelle infantile se camoufle aussi bien au sein d’idéologies dites progressistes, égalitaristes ou même féministes. En effet, de la vengeance voilée à l’égard du détenteur phallique, systématiquement vilipendé comme représentant d’une « masculinité toxique » aux systématisations où la revendication phallique se travestit au nom de l’égalité – « tous égaux », « tous privilégiés », « tous riches » – les expressions idéologiques du fantasme inconscient ont des incidences sociales délétères.
De même, la découverte freudienne met aussi en lumière comment les fantasmes refoulés se confondent avec des théories. L’exemple actuel de la théorie du genre est particulièrement représentatif des ravages que produisent ces fantasmes en se représentant, de manière détournée, au nom de la science et du progrès : cette pseudo théorie conduit à perpétuer des mutilations, au nom du respect et du droit fantasmatique à l’autodétermination ou encore à des prescriptions, au nom de la médecine et de la santé, de traitements hormonaux aux effets non seulement irréversibles mais nocifs pour la santé.
Les conséquences paradoxales et destructrices de ces systèmes pseudo-scientifiques mettent en exergue la dimension politique de la psychanalyse ; Car si les symptômes psychiques des êtres parlants ne peuvent se dénouer sans la traversée des fantasmes inconscients, la psychanalyse éclaire en même temps les problématiques épistémiques et sociales qu’induisent ces croyances infantiles, notamment quand le fantasme se transforme en théorie.
[1] Freud, S. (1915). « Trois essais sur la théorie sexuelle » in Œuvres complètes VI (1901-1905), Paris, puf, 2009, pp. 131-132
[2] Amorim (de), F. Fantasme originaire, fantasme fondamental et fantasme œdipien, 2024, consulté le 7 décembre 2024, https://www.fernandodeamorim.com/fantasme-originaire-fantasme-fondamental-fantasme-oedipien/